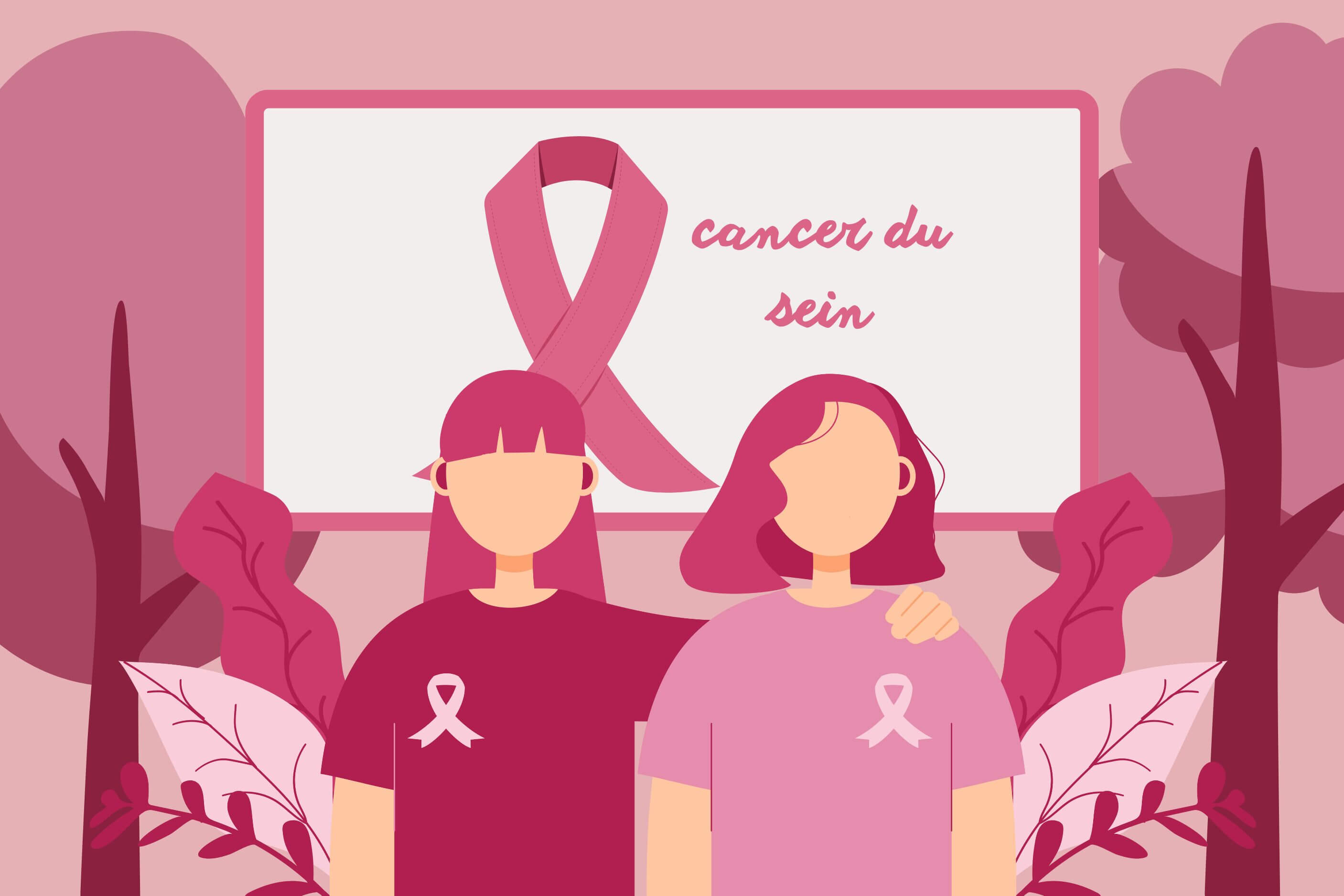
Cancer du sein : au-delà de l’expérience personnelle
Crédit visuel : Élodie Ah-Wong— Directrice artistique
Article rédigé par Sandra Uhlrich — Journaliste
Octobre rose, le mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, vient de se terminer. Pourtant, l’importance de parler de cette maladie demeure. Au delà des rubans roses, il est essentiel d’ouvrir un dialogue collectif pour briser l’isolement qui accompagne trop souvent le cancer — un dialogue qui concerne tout le monde, peu importe l’âge ou le sexe.
Pourquoi octobre rose ?
Près d’une femme sur huit serait touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Heureusement, son traitement reste très optimiste : au Canada, le taux de survie à 5 ans au cancer du sein chez la femme est juste en dessous de 90%. Initiative lancée dans les années 1980 aux États-Unis, le mois d’octobre vise aujourd’hui à sensibiliser la population à cette maladie. Le ruban rose y est également associé, comme symbole de solidarité envers les personnes touchées et leurs proches.
Roanne Thomas, professeur titulaire à la Faculté des Sciences de la santé, remarque toutefois une baisse des initiatives liées à ce mois. Elle l’explique notamment par la dissolution de plusieurs organismes de financement qui soutiennent la recherche sur le cancer du sein.
La professeure en psychologie Sophie Lebel ajoute également que l’usage excessif du ruban rose ces dernières années — davantage par stratégie marketing que par réel engagement — a suscité plusieurs critiques et entraîné une diminution de sa portée symbolique et de son utilisation.
Pour sa part, Femi Salam-Alada, coordonnatrice des événements au centre des ressources féministes du SÉUO, confirme que, bien qu’elle étudie en science de la santé, elle n’en a pas entendu parler en classe. Pour elle, il demeure donc nécessaire de continuer à discuter.
L’importance d’en parler tôt
Bien que les femmes de 40 ans et plus soient les plus touchées par ce cancer, les femmes plus jeunes restent à risque. D’où l’importance d’en parler tôt, souligne Salam-Alada : « Quand il s’agit de la santé des femmes, s’y intéresser à un jeune âge est plus bénéfique pour nous personnellement ainsi que pour la société dans son ensemble. »
Comme le rappelle Lebel, les saines habitudes de vie permettent de réduire les risques liés au cancer, mais elles doivent être adoptées tout au long de la vie, dès le plus jeune âge. Il devient donc essentiel de sensibiliser les plus jeunes dès que possible.
Salam-Alada estime également que le milieu universitaire, propice au partage d’informations, pourrait jouer un rôle fondamental dans cette sensibilisation. Cela permettrait de mettre en avant les gestes de prévention afin de favoriser une détection précoce : « Être informé.e te permet de savoir quoi observer. »
Lebel note que les jeunes femmes se sentent souvent moins concernées. Pourtant, lorsque ce cancer touche les populations plus jeunes, il a tendance à être plus agressif. Pour elle, il est primordial de connaître son corps et de lui faire confiance. Elle insiste notamment sur l’importance de consulter un.e professionnel.le de santé dès qu’un symptôme est reconnu, et surtout de ne pas hésiter à poser des questions.

La honte peut être ressentie suite à une modification de l'image corporelle après une mastectomie totale ou à la perte des cheveux. (source: vivrecommeavant.fr). ©Capture d'écran sur internet.
Thomas ajoute que la sensibilisation permet de comprendre aussi « les défis auxquels nos proches et nos ami.es pourraient être confronté.es s’ils reçoivent un diagnostic de cancer, et comment les soutenir au mieux pendant et après le traitement ». Également, selon elle, les réseaux de soutien jouent un rôle énorme dans l’appréhension et la gestion de la maladie, notamment par le soutien émotionnel qu’ils peuvent offrir.
Lebel encourage toute personne accompagnant une personne atteinte de cancer à simplement poser la question : « De quoi as-tu besoin? ». Thomas partage cette approche et recommande de « se laisser vraiment guider par la personne qui vit cette expérience. C’est un cliché, mais chacun est différent».
Que vous ou un.e de vos proches soit en proie à ce cancer, il existe de nombreuses ressources pour vous accompagner, telles que la Société canadienne du cancer, la Fondation québécoise du cancer, ou encore The Ottawa cancer fondation.
Tabous et vie après le cancer
Si le cancer du sein est aujourd’hui largement discuté, ses effets à long terme, en particulier sur le plan mental, demeurent encore tabous. Selon Lebel, une idée persiste : une fois les traitements terminés, la personne retrouverait sa vie d’avant. Pourtant, ce n’est pas le cas, car cette maladie transforme profondément la personne, tant physiquement que mentalement.
Sur le plan de l’image corporelle, les effets psychologiques d’une reconstruction mammaire restent encore peu abordés. Salam-Alada souligne l’impact que cela peut avoir sur le couple, les relations interpersonnelles et la perception de soi : « Dans le cas où vous devriez subir une chirurgie, vous perdez quelque chose qui, pour beaucoup de gens, fait de vous une femme. » Elle note cependant que définir socialement la féminité par l’apparence reste problématique – « mais c’est un autre débat », ajoute-t-elle. Il reste donc essentiel de prendre en compte cet effet.
Pour Lebel, le langage utilisé pour parler des personnes ayant survécu au cancer importe également : « Ce n’est pas tout le monde qui va nécessairement avoir ce qu’on appelle un parcours triomphant. […] Certains s’identifient au terme “survivant”, d’autres trouvent ça aliénant. » Il faut donc prendre davantage en compte la pluralité des expériences, et respecter la manière dont chaque personne souhaite aborder la sienne.
Salam-Alada conclut en rappelant l’importance d’adresser cette maladie malicieuse de manière collective, afin d’aider « les femmes à se sentir un peu moins honteuses de parler de leurs expériences avec le cancer du sein». Elle insiste surtout sur l’intégration de chacun.e dans la conversation, et l’importance de créer des espaces de soutien inclusifs et bienveillants.
