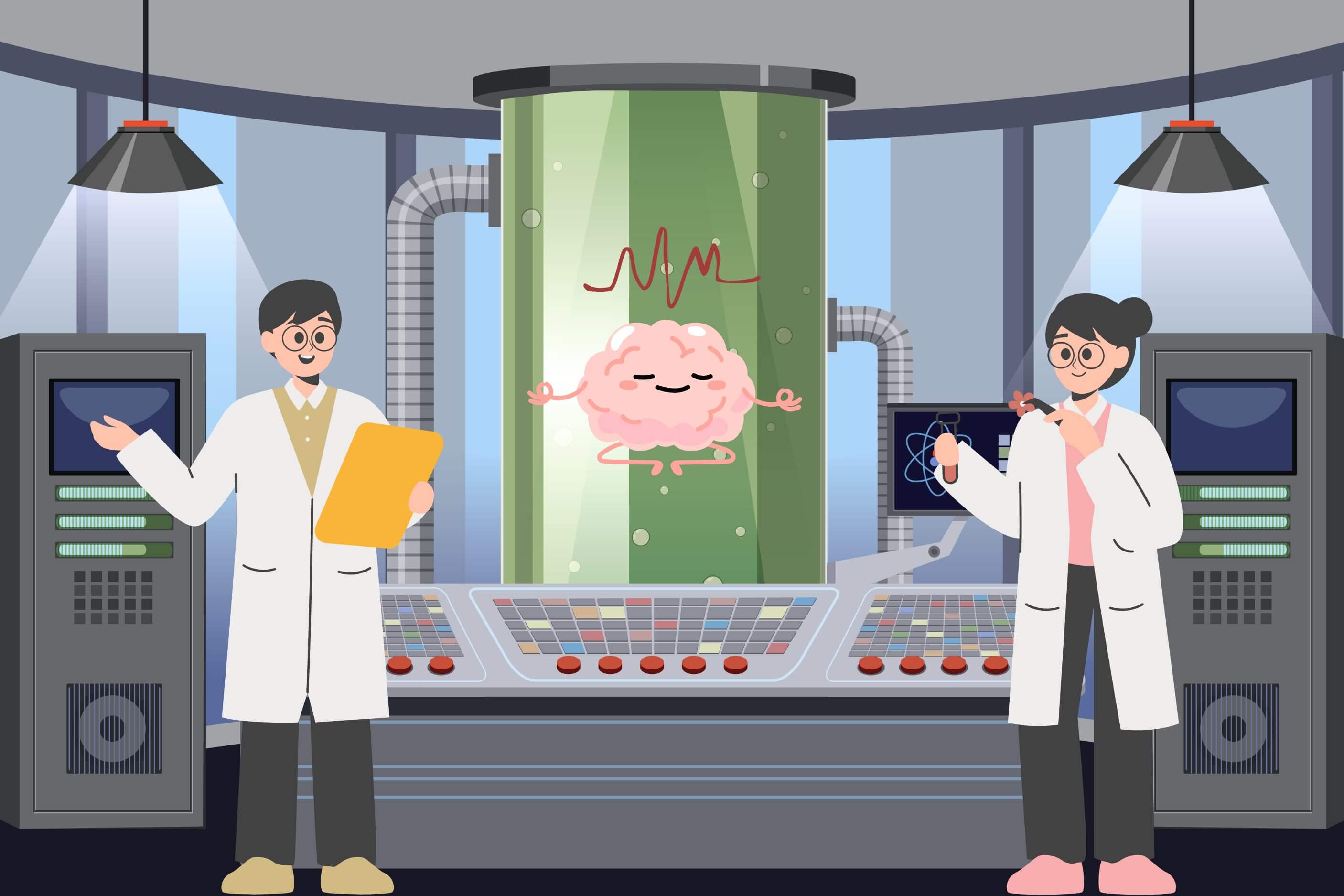
Combien de temps une pensée reste-t-elle dans le cerveau ?
Crédit visuel : Élodie Ah-Wong- Directrice artistique
Entrevue rédigée par Lê Vu Hai Huong — Journaliste
Une réponse éclairante à cette question émerge de l’étude « Distinct timescales dissociate spontaneous thought dimensions » dirigée par le Dr Georg Northoff et publiée le 17 septembre dernier. Neuroscientifique et psychiatre à l’Institut de recherche en santé mentale du Royal, il est également professeur de psychiatrie à l’Université d’Ottawa.
À travers cette étude, le Dr Georg Northoff et son équipe démontrent que les pensées centrées sur soi s’étendent sur une période plus longue, tandis que les pensées tournées vers l’extérieur durent moins longtemps. Cette découverte permet aussi de différencier la dépression majeure de la dépression bipolaire, qui nécessite des traitements différents.
« La présente étude ouvre une perspective totalement nouvelle sur les troubles mentaux et la manière dont nous pourrions un jour diagnostiquer et personnaliser les traitements à partir de la dynamique de la pensée, et non plus uniquement des symptômes », explique le chercheur dans un article de l’Université d’Ottawa.
Pour en discuter davantage, nous avons rencontré la Dre Florence Dzierszinski, présidente et cheffe de la direction de l’Institut de recherche en santé mentale (IRSM) de l’Université d’Ottawa, et vice-présidente de la recherche au Royal.
La Rotonde (LR) : Comment cette découverte sur l’échelle de temps de la pensée pourrait-elle transformer concrètement le diagnostic de la dépression et du trouble bipolaire dans les cliniques du Royal ?
Florence Dzierszinski (FD) : La dépression et les troubles bipolaires se caractérisent par des modifications du rythme de la pensée : certaines pensées s’emballent, d’autres sont anormalement ralenties. Jusqu’à présent, nous ne pouvions mesurer ni la vitesse de la pensée, ni son échelle de temps. Désormais, cette étude rend cela possible. Après des tests chez des patient.e.s souffrant de dépression, il sera envisageable d’utiliser la pensée elle-même comme marqueur diagnostique, en mesurant la vitesse ou les échelles de temps de la pensée.
LR : Le Royal prévoit-il d’intégrer cette mesure du « tempo de la pensée » comme outil de dépistage ou de suivi des patient.e.s ? Et si oui, selon quel calendrier ?
FD : Nous avons effectivement l’intention de le faire dès l’année prochaine, comme outil de dépistage diagnostique pour le trouble bipolaire et le trouble dépressif majeur.
LR : Comment les patient.e.s réagissent-ils lorsqu’on leur explique que leur « rythme de pensée » peut être mesuré et même ajusté ? Est-ce que cela change leur manière de comprendre ou de vivre leur maladie ?
FD : Avec un peu de surprise au début, mais aussi beaucoup d’intérêt, puisque cette approche leur offre des solutions réelles sur lesquelles ils et elles peuvent agir, et ces solutions sont relativement simples à implémenter comparativement à d’autres approches. Bien sûr, cela contribue également à réduire la stigmatisation.
LR : Au-delà du diagnostic, comment la mesure du rythme de la pensée pourrait-elle contribuer à élaborer des interventions préventives ou de bien-être dans la communauté ?
FD : C’est une très belle expression : le rythme de la pensée. Nous pouvons modifier thérapeutiquement ce rythme ou ces échelles de temps de la pensée, par exemple à l’aide de musique adaptée à la vitesse et au rythme de pensée de chaque individu. Cela permet de réduire et de « normaliser » les schémas de pensée. C’est d’ailleurs déjà ce que nous faisons, en appliquant des rythmes respiratoires et des vitesses musicales personnalisées.
LR : Cette approche pourrait-elle être adaptée pour mieux comprendre et soutenir les jeunes francophones de la région d’Ottawa et de l’Est ontarien qui souffrent de troubles de l’humeur ?
FD : Absolument. Nous ciblons particulièrement les adolescents et jeunes adultes, qui présentent une augmentation des cas de dépression. Plus nous pouvons dépister et diagnostiquer tôt leur dépression, notamment à travers leurs schémas de pensée anormaux, plus nous pourrons intervenir rapidement, de manière ciblée, et prévenir des formes sévères de dépression.
LR : Puisque cette découverte a été faite à Ottawa, comment le Royal prévoit-il de mettre en valeur cette percée scientifique locale tout en collaborant avec d’autres centres de recherche au Canada et à l’international ?
FD : Le chercheur principal de l’étude, Georg Northoff, entretient de nombreuses collaborations nationales et aussi à travers l’Europe et l’Asie. Il prévoit d’utiliser le test de vitesse de la pensée chez des patient.e.s dépressif.ve.s, anxieux.ses et schizophrènes, dans le cadre d’un premier dépistage diagnostique différentiel.
LR : Pensez-vous que cette approche pourrait un jour être intégrée dans des outils accessibles au grand public (par exemple via une application ou des programmes de prévention communautaires) ?
FD : Absolument. C’est une approche très accessible, et un excellent exemple de ce que la « Recherche donne Accès aux Soins » peut offrir. Nous travaillons activement à des partenariats communautaires.
