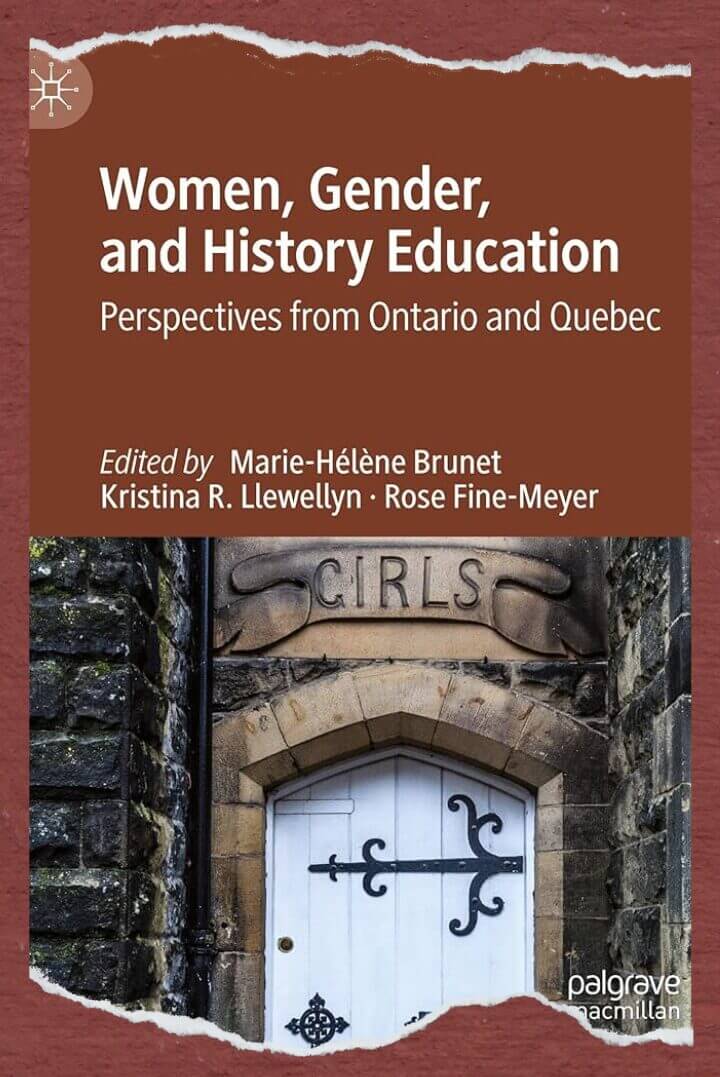
Un regard féministe sur l’éducation historique en Ontario et au Québec
Article rédigé par Tom Chazelle Schulze — Journaliste
Dans un contexte où les récits historiques restent largement dominés par des récits patriarcaux, l’ouvrage collectif Women, Gender and History Education : Perspectives from Ontario and Québec ouvre un débat sur la place des femmes dans l’enseignement de l’histoire. Le lancement de l’œuvre a eu lieu le 4 mars dernier, au Pavillon Lamoureux de l’Université d’Ottawa (U d’O).
L’événement a rassemblé les éditrices et autrices de l’oeuvre, dont Marie-Hélène Brunet, professeure en didactique des sciences sociales à l’U d’O, Rose Fine-Meyer, professeure d’éducation à l’Université de Toronto, et Tifanie Valade, professeure à temps partiel à la Faculté d’éducation de l’U d’O. Lors du lancement, elles ont insisté sur l’urgence de déconstruire les biais historiques et de réinventer la manière dont l’histoire est enseignée dans les écoles.
La structure et les ambitions du livre
L’ouvrage s’articule autour de trois grandes sections : le passé, le présent et le futur, mentionne Brunet. Elle présente cet ouvrage comme étant une initiative pionnière visant à analyser l’enseignement de l’histoire des femmes au Canada, avec une attention particulière portée au Québec et à l’Ontario.
Fine-Meyer, Valade et Brunet expliquent que l’intégration des femmes dans l’enseignement de l’histoire n’a pas été un processus linéaire. Les trois expertes soulignent que, depuis les années 1970, des chercheuses et éducatrices militent pour que les femmes ne soient plus reléguées à des rôles secondaires, ou même considérées comme de simples « figures exceptionnelles » dans les récits historiques.
Le livre met également en lumière les limites des curriculums scolaires actuels, où l’histoire des femmes est souvent abordée de manière superficielle. Brunet explique que, pendant trop longtemps, la question de l’inclusion de l’histoire des femmes s’est limitée à une approche « add and stir », qui consiste à ajouter ponctuellement des figures historiques féminines sans remettre en question la structure même du récit historique.
La dernière partie du livre, d’après les autrices, propose des pistes concrètes dédiées aux enseignant.e.s en histoire, afin qu’il.elle.s puissent intégrer des perspectives féministes dans leur enseignement, avec pour objectif la sensibilisation et l’accessibilité des ressources adaptées.
Un récit historique androcentré
Les autrices expliquent que l’histoire des femmes est souvent abordée selon plusieurs approches problématiques. D’après elles, la présence des femmes dans l’histoire est fréquemment marginalisée, réduite à quelques chapitres ou encadrés spécifiques, sans véritable intégration dans le récit historique global. Elles mentionnent également que les femmes sont souvent présentées comme un groupe universel et homogène, majoritairement constitué de femmes blanches et issues de la bourgeoisie, ce qui exclut les expériences des femmes racisées, autochtones ou de la classe ouvrière.
Fine-Meyer, Valade et Brunet soulignent d’ailleurs qu’en Ontario et au Québec, les efforts pour rendre les programmes d’étude plus inclusifs restent encore largement insuffisants. Elles expliquent qu’en Ontario, même si les questions de genre figurent dans certains contenus spécifiques, elles ne font pas partie des attentes générales des curriculums. Cela laisse donc le choix aux enseignant.e.s d’inclure ou non ces questions dans leurs cours.
Fine-Meyer déplore particulièrement le fait que nombreux manuels scolaires encore utilisés aujourd’hui sont datés et constituent donc un obstacle majeur à l’enseignement des perspectives féministes. En effet, certains manuels datent des années 1970, une époque où la représentation des femmes et des questions de genre était selon elle quasi inexistante.
Vers une approche féministe et inclusive de l’histoire
D’après les autrices, l’ouvrage appelle à repenser l’enseignement de l’histoire afin de mieux en saisir la diversité. En dénonçant une approche éducative encore trop androcentrée et en proposant des pistes concrètes pour un enseignement plus inclusif, les autrices plaident pour une histoire dans laquelle les femmes ne seraient plus invisibilisées.
Selon Fine-Meyer, les enseignant.e.s doivent éviter l’essentialisation, qui perpétue des stéréotypes genrés, comme l’affirmation selon laquelle « les garçons sont meilleurs en sciences, les filles meilleures en langues ». Ils et elles doivent aussi se méfier de la fausse neutralité, qui évite les débats sur les inégalités : selon elle, ignorer ces questions revient à perpétuer les inégalités et injustices existantes.
Brunet insiste sur l’importance de ne pas se limiter aux faits : elle encourage à aller au-delà en enseignement afin de favoriser l’analyse des élèves. L’autrice révèle ainsi que comprendre l’histoire, s’y ouvrir et s’y engager n’est pas un remède miracle, mais assure que cela ouvre la porte à une réflexion historique plus approfondie et à une recherche de complexité.
