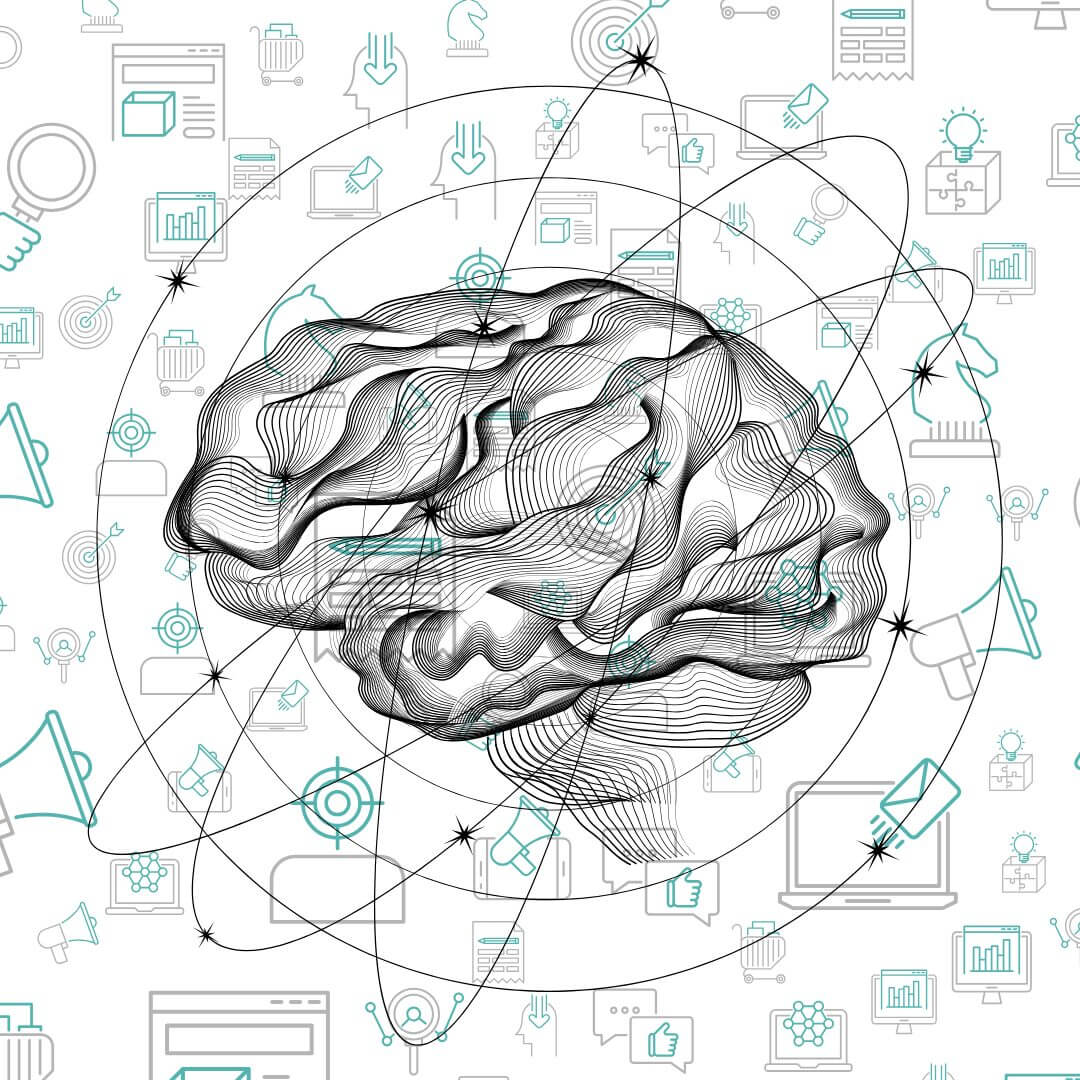
Désir et consumérisme : sommes-nous vraiment libres de choisir ?
Crédit visuel : Hidaya Tchassanti — Directrice artistique
Article rédigé par Jessica Malutama — Cheffe du pupitre Sports et bien-être
Dans une société où la consommation et différentes formes de sollicitations sont omniprésentes, nos désirs sont-ils réellement les nôtres ? Alors que les neurosciences appliquées décryptent les mécanismes de la prise de décision, la philosophie bouddhique nous invite à interroger la nature même du désir. Avons-nous vraiment le contrôle sur nos envies, ou sommes-nous poussé.e.s à vouloir toujours plus ? L’accumulation incessante de biens nous rend-t-elle véritablement heureux.ses ?
Le cerveau, au coeur des décisions de consommation
Vinod Ventrakaman, professeur de marketing à la Fox School of Business de l’Université Temple, s’intéresse aux processus cognitifs et émotionnels qui guident nos choix. Il explique que nos décisions d’achat sont parfois bien moins rationnelles qu’on ne le pense.
« Dans la vie quotidienne, notre capacité de traitement est limitée », explique l’expert. Il émet que nos décisions sont souvent influencées par des habitudes et des automatismes, sans que nous en soyons pleinement conscient.e.s.
Le travail de Ventrakaman vise à comprendre ces mécanismes et à les appliquer aux stratégies marketing : « on croit souvent à tort que le neuromarketing est une forme de manipulation, qui tente de modifier quelque chose dans notre cerveau ou d’influer directement sur nos choix ». Pourtant, selon lui, il s’agit plutôt d’analyser les facteurs qui déterminent les préférences et orientent les comportements des individus. D’ailleurs, Venkatraman préfère parler de « neuroéconomie », qui englobe la prise de décision humaine dans son ensemble, au-delà du simple « neuromarketing ».
L’émotion, moteur de nos achats
Si tous les produits ne sont pas synonymes de luxe ou de plaisir immédiat, les publicités qui leur sont dédiées cherchent néanmoins à susciter une réaction émotionnelle forte, note le professeur.
L’objectif est notamment de détourner l’attention du prix et de déclencher un sentiment de plaisir anticipé lié à la possession future du produit. Le chercheur évoque l’exemple des produits alimentaires, où les professionnel.le.s du marketing s’efforcent de provoquer « une envie irrésistible » pour inciter les consommateur.ice.s à acheter.
Si l’intensité et la nature des émotions jouent un rôle clé, Venkatraman souligne qu’un autre facteur entre en jeu : la désirabilité, soit ce qui rend un produit attrayant. Il explique que notre attirance pour un produit repose en grande partie sur le système de récompense de notre cerveau. Lorsqu’un stimulus active la zone dopaminergique, « il génère une réaction positive accrue », précise-t-il.
D’après lui, les publicités du Super Bowl en sont un exemple marquant : plutôt que de vanter l’utilité d’un produit, elles cherchent à associer marque et plaisir afin de créer un attachement affectif.
Le désir : une quête sans fin ?
Le bouddhisme, dans une perspective philosophique, perçoit le désir (tanha) comme un mouvement perpétuel, une « soif » insatiable qui laisse toujours celui.celle qui l’éprouve dans un état de manque constant.
Catherine Collobert, professeure de philosophie à l’Université d’Ottawa et spécialiste des philosophies bouddhique et antique, explique que ce désir n’apporte jamais de véritable satisfaction, car, dès qu’un objet est obtenu, un nouveau désir surgit.
Paradoxalement, l’experte souligne que nous ne désirons pas tant l’objet lui-même que la disparition du manque qu’il provoque – un manque qui est source de souffrance. Cette même disparition procure un plaisir éphémère, nourrissant un cycle sans fin.
Selon elle, cette dynamique est au cœur du consumérisme, qui se base sur ce fonctionnement précis de l’esprit. « On achète un iPhone, puis on veut le modèle suivant, et ainsi de suite. On vit dans une société où il y a une multiplication des objets soi-disant désirables ».
D’ailleurs, la professeure souligne que le désir n’est pas une réalité objective, mais une construction mentale. Autrement dit, nous croyons désirer un objet pour ses qualités propres, alors qu’en réalité, c’est notre esprit qui le rend attirant en lui attribuant une valeur particulière.
Vers une consommation plus consciente ?
Venkatraman nuance l’idée selon laquelle nos choix de consommation seraient entièrement automatiques. D’après lui, nos raccourcis cognitifs ne sont pas nécessairement négatifs, car ils nous aident aussi à naviguer dans un monde saturé de sollicitations.
Collobert, en revanche, y voit un paradoxe fondamental : nous croyons être libres en satisfaisant nos désirs, alors qu’en réalité, nous répondons à des influences extérieures, sans réel contrôle sur le processus. Elle explique que dès que nous voyons un objet, on lui attribue des qualités qui le rendent désirable, un processus entraînant l’action, puis l’achat.
Pour contrer cette réactivité, Venkatraman préconise une prise de décision plus rationnelle par rapport aux influences externes qui façonnent nos choix. Il recommande de ralentir le processus de décision afin d’éviter les achats impulsifs.
Il ajoute : « en tant que consommateur.ice, il est important de faire une pause […] afin de s’assurer que l’on prend au moins en considération les informations dont on dispose ». Collobert, pareillement, insiste sur la nécessité d’un recul introspectif, inspiré par le bouddhisme et fondé sur la pleine conscience du désir.
Pour briser l’automatisme et faire un choix plus conscient, elle suggère de prendre un instant pour observer son désir, sans y céder immédiatement. Il est possible selon Collobert de modifier ses habitudes et sa manière de réagir aux désirs par des pratiques quotidiennes.
Elle conseille notamment « la minute de pleine conscience » : mettre une alarme sur son téléphone toutes les heures pour prendre une minute de recul et se concentrer sur sa respiration. Cette pratique permet de cultiver la présence et la conscience dans l’instant, favorisant ainsi une relation plus calme avec ses désirs et donc une prise de décision plus réfléchie, exprime l’experte.
La nécessité de repenser le bonheur
D’après la professeure à l’Université d’Ottawa, ce recul soulève une question philosophique plus fondamentale : qu’est-ce que le bonheur ? « Tout le monde désire être heureux.se, mais peu d’individus s’interrogent véritablement sur ce que cela veut dire », remarque-t-elle.
Elle observe que, dans notre société consumériste, le bonheur est souvent réduit à une accumulation d’objets ou de plaisirs instantanés. Mais Collobert relève ce problème fondamental : le désir d’objets, insatiable par nature, rend le bonheur fondé sur leur satisfaction toujours instable.
S’appuyant sur les philosophies antique et bouddhique, elle propose une approche plus durable du bonheur qui, selon elle, ne peut être fondée sur des objets extérieurs, au risque d’être toujours vulnérable.
Pour elle, le bonheur véritable est « lié à une certaine intériorité ». Ainsi, plutôt que de chercher à assouvir des satisfactions éphémères, selon la professeure, il y a nécessité de « tourner notre regard vers nous-mêmes ».
Elle conclut : « Si on comprend que le plaisir, ce n’est pas le bonheur, et que le bonheur véritable, c’est la tranquillité et la paix, on arrête d’être dans cette quête permanente du plaisir et des objets qui sont censés nous satisfaire. »
