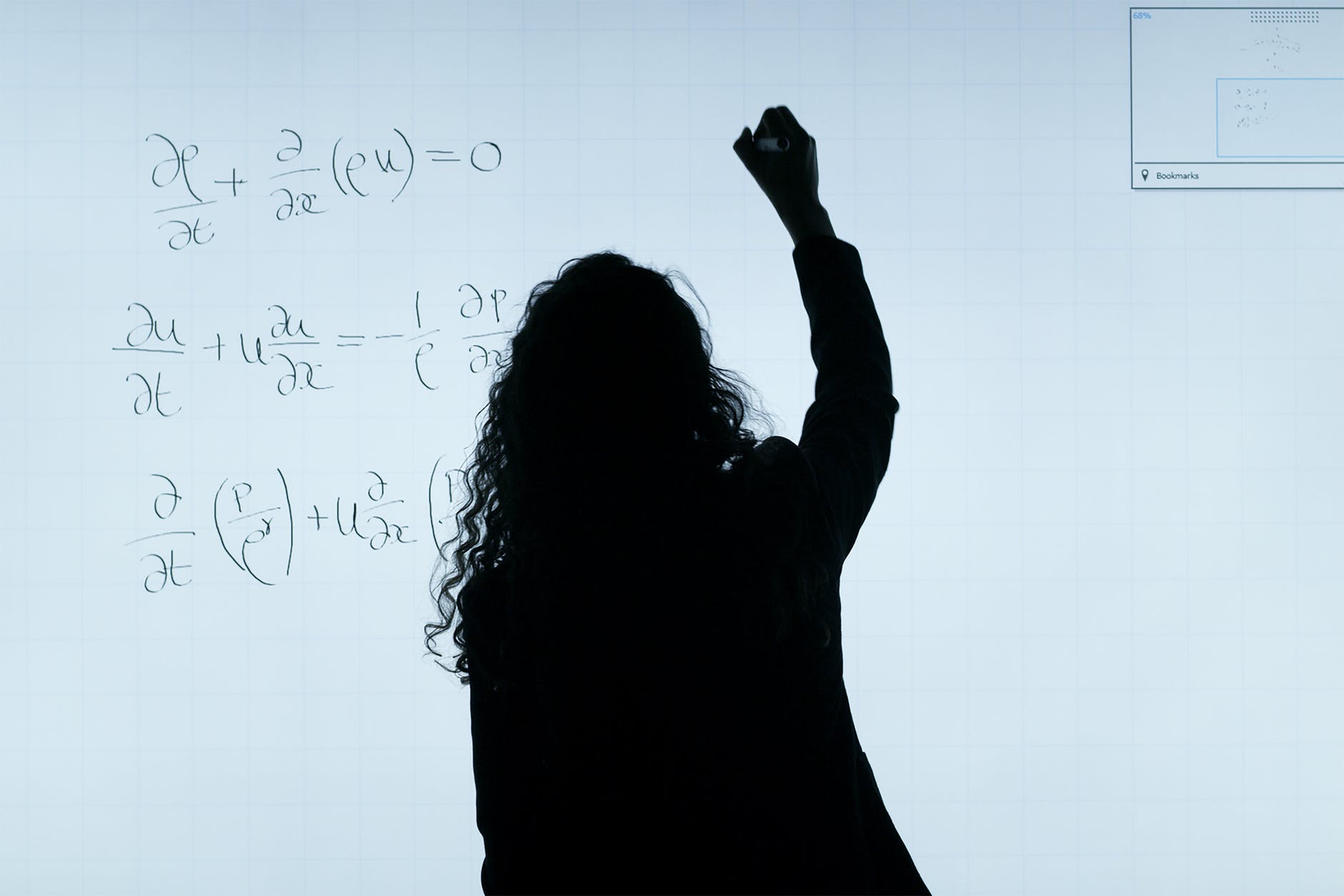
Entre passion et contrainte, le quotidien contrasté des jeunes professeur.e.s universitaires
Crédit visuel : Pexels – Courtoisie
Article rédigé par Camille Cottais – Cheffe du pupitre Actualités
Comment devient-on professeur.e. à l’université ? À quoi ressemble le quotidien des jeunes professeur.e.s de l’Université d’Ottawa (U d’O) ? À quelles difficultés font-ils.elles face ? Pour répondre à ces questions, quatre professeur.e.s aux profils variés ont été interrogé.e.s : une professeure adjointe, deux doctorant.e.s et un futur post-doctorant.
Si elle est parfois qualifiée de plus beau métier du monde, la profession de professeur.e s’accompagne également de son lot de difficultés, comme l’expliquent les sources. Entre la planification et la dispensation des cours, la correction des copies, les activités de recherche, les complications administratives… les tâches des professeur.e.s sont multiples. De plus, leur passion pour leur travail n’empêche pas leur quotidien d’être souvent compliqué et pléthorique.
Différents types de professeur.e.s pour différentes conditions de travail
Maïka Sondarjee a été engagée comme professeure à temps plein en développement international et mondialisation, peu après la fin de son doctorat en 2020. Une situation privilégiée qui ne reflète pas l’expérience de la plupart des jeunes doctorant.e.s. Selon Sondarjee, il ne s’agit pas seulement d’une question de compétence ou de travail, mais aussi de chance et de privilèges. Même avec un doctorat en poche et un très bon CV, il est fort probable de ne pas trouver de travail, explique-t-elle.
Engagée comme professeure adjointe, elle pourra demander sa permanence dans cinq ans et ainsi devenir professeure agrégée. L’accès au titre de professeur.e titulaire est quant à lui plus long (15 ans de carrière) et moins assuré. C’est ce qu’on appelle le tenure contract, qui s’oppose au contrat temporaire des chargé.e.s de cours, ou professeur.e.s à temps partiel. Ces dernier.ère.s sont engagé.e.s par semestre et par cours, sans garantie de renouvellement, exprime la professeure adjointe.
Arnaud Montreuil, doctorant en histoire et professeur à temps partiel, confirme que le statut le plus précaire et le plus difficile est celui de chargé.e de cours. Il rappelle que les professeur.e.s à temps partiel ne jouissent pas des mêmes avantages que les professeur.e.s à temps plein, comme la sécurité d’emploi. Selon lui, il y a un certain manque de reconnaissance, monétaire comme sociale, envers les professeur.e.s à temps partiel, alors même qu’ils.elles enseignent la majorité des cours à l’U d’O et jouent donc un rôle central dans le fonctionnement de l’enseignement universitaire.
Un milieu très compétitif et des postes qui se font rares
Jérôme Gosselin-Tapp a enseigné plusieurs cours de philosophie lors de son doctorat à l’U d’O, et débutera au prochain semestre un post-doctorat à l’Université Queen’s de Kingston. Il avance que les postes permanents sont très rares, rendant ainsi précaire et incertain le statut des jeunes doctorant.e.s.
« Les ouvertures se font au compte goutte et la compétitivité est très forte en ce moment », continue-t-il, poussant les aspirant.e.s enseignant.e.s à écrire le plus de publications possibles et à diversifier au maximum leurs intérêts de recherche. Il explique que lorsque l’on s’engage dans le monde académique, il n’y a aucune garantie de réussir à faire carrière.
Cette difficulté pour obtenir un poste permanent est ce qui a poussé Pascale Dangoisse, candidate au doctorat et professeure à temps partiel en communication, à renoncer partiellement à la perspective d’une carrière universitaire. En tant que mère monoparentale, elle est contrainte de rester dans la région d’Ottawa-Gatineau, et ne peut donc pas postuler ailleurs au Canada, en Europe ou aux Etats-Unis.
Sondarjee explique que lorsqu’un poste de professeur.e à temps plein ouvre dans une université francophone, il y a plus d’une centaine de personnes qui appliquent, et plusieurs centaines pour les universités anglophones.
Un mode de vie très exigeant
Tou.te.s les professeur.e.s interrogé.e.s s’accordent pour affirmer qu’il s’agit d’une profession qui requiert énormément de travail. Au doctorat, raconte Sondarjee, « on disait qu’être professeur.e, c’était comme si c’était tous les jours samedi, mais un samedi où on travaille », c’est-à-dire qu’il faut bien gérer son temps et qu’on ne sait pas quand arrêter. Le grand danger de ce travail, explique Montreuil, est de ne pas se mettre de limites sur le temps qu’on passe à écrire, chercher et enseigner.
Combien d’heures par semaine travaillent en réalité les professeur.e.s ? Sondarjee estime travailler en moyenne 50 heures par semaine. Il est cependant difficile d’estimer un nombre d’heures précis, car la distinction entre vie privée et professionnelle est très floue, rapporte-t-elle. Par exemple, « est-ce que lire des livres, dîner avec une collègue ou participer au débat public est du travail ? », se demande la professeure.
Pour Gosselin-Tapp, il n’y a même aucune distinction entre les sphères privée et professionnelle : « J’ai l’impression que ma vie correspond à ma carrière », rapporte-t-il. Il explique devoir travailler en fin de semaine et en soirée, et avoir dû faire de nombreux sacrifices pour augmenter ses chances d’obtenir un poste.
Pour Sondarjee, il faut cependant nuancer. Selon elle, il ne faut pas promouvoir l’idée que les professeur.e.s travaillent 70 heures par semaine. Elle rappelle l’importance d’arrêter de travailler la fin de semaine, de prendre des vacances et de continuer à avoir une vie sociale en dehors de l’Université, contre un discours néolibéral qui promeut de travailler toujours plus.
C’est cette même idéologie néolibérale, qui, selon Montreuil, promeut la quantité et non la qualité des publications. Les professeur.e.s sont ainsi toujours encouragé.e.s à faire plus pour se démarquer, et donc à se comparer les un.e.s aux autres.
Un métier de passion et de liberté
Malgré les difficultés rencontrées, aucun.e des professeur.e.s interrogé.e.s ne semble regretter d’avoir choisi cette voie. Gosselin Tapp se réjouit de la flexibilité et de l’agentivité que permet le métier de professeur.e, peu commune dans d’autres professions, même si cette liberté s’accompagne de plus d’heures de travail. « C’est un mode de vie qui apporte beaucoup mais qui demande aussi beaucoup », affirme le jeune doctorant.
Il se déclare également chanceux de pouvoir se consacrer à des choses qui le passionnent. Malgré les difficultés pour obtenir un poste permanent et la grande quantité de travail requise, le processus est selon lui enrichissant, et le milieu plus stimulant que la majorité des autres domaines. Montreuil évoque également le bonheur d’enseigner, particulièrement lorsque les élèves veulent apprendre et aiment réfléchir. C’est pour lui une chance et un honneur « de se faire confier la formation d’esprits en plein éveil ».
Il s’agit d’un milieu qui demande un fort niveau d’engagement personnel, explique Gosselin-Tapp, car « on n’investit pas dans une entreprise ou une organisation mais dans nous, dans notre personne ». La passion pour leurs travaux de recherche et pour l’enseignement explique selon lui que les professeur.e.s aient tendance à « donner sans compter ».
Montreuil confirme qu’il s’agit d’un métier vocationnel, mais qu’il ne faut pas que cette passion du métier serve de justification pour ne pas payer les professeur.e.s ou pour ne pas leur offrir des conditions de travail à la hauteur de ce qu’ils.elles offrent. La promotion néolibérale de l’amour du métier justifie souvent selon lui de ne pas compter ses heures, et même de couper le salaire et la sécurité d’emploi, que ce soit pour les professeur.e.s ou pour d’autres métiers dits vocationnels, comme les infirmier.ère.s.
