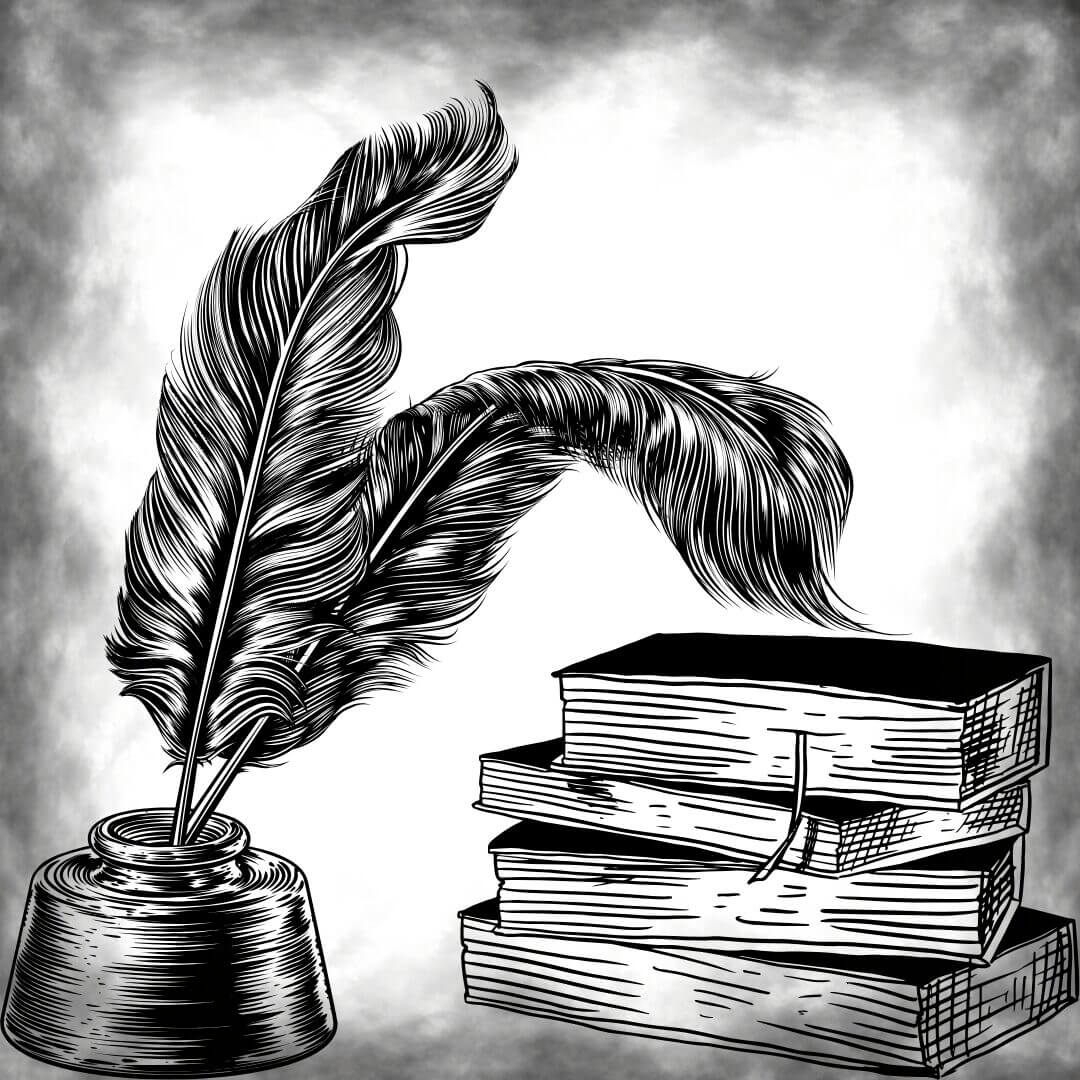
Les plumes d’Ottawa : une littérature à défendre et à célébrer
Crédit visuel : Hidaya Tchassanti — Directrice artistique
Article rédigé par Tom Chazelle Schulze — Journaliste
Ottawa, ville d’institutions officielles et de bilinguisme, cache une littérature francophone vibrante, qui a su s’imposer dans un environnement dominé par l’anglais. Depuis plusieurs décennies, écrivain.e.s et poètes franco-ontarien.ne.s pratiquent une littérature unique, influencée par une expérience de langue minoritaire.
Les voix fondatrices de la littérature franco-ontarienne
François Paré, professeur et directeur du Département d’études françaises à l’Université de Waterloo et écrivain franco-ontarien, explique que la littérature franco-ontarienne ne date pas d’hier. Même si son essor remonte aux années 1970, des voix franco-ontariennes se faisaient déjà entendre bien avant cela. Le professeur explique que Régis Roy, fonctionnaire du gouvernement fédéral, a été l’un des premiers auteurs franco-ontariens, publiant dès le 19e siècle du théâtre et des nouvelles avec les quartiers d’Ottawa en décor. L’expert note cependant qu’après cette période, il y a eu un assez long silence, laissant la littérature franco-ontarienne en suspens jusqu’aux années 1970.
D’après Lucie Hotte, ancienne professeure du Département de français de l’Université d’Ottawa (U d’O) et ancienne directrice du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, c’est à cette époque que la littérature franco-ontarienne a connu un véritable renouveau identitaire. Hotte explique que cette période était marquée par l’envie de rompre avec l’idée d’un « Canada français » unifié : les auteur.ice.s de l’époque cherchaient à construire une littérature autour d’une volonté de s’exprimer, inspirée par le contexte politique du moment. Dans un effort d’atteindre cette affirmation identitaire, les années 1970 ont été marquées par la création d’institutions littéraires franco-ontariennes, telles que le Théâtre du Nouvel-Ontario en 1971 ou encore les Éditions Prise de Parole en 1973, qui ont largement contribué à la structure culturelle franco-ontarienne.
L’U d’O, un incubateur ?
L’U d’O a longtemps formé et diffusé les œuvres des écrivain.e.s franco-ontarien.ne.s, d’après Hotte. Cette dernière mentionne notamment Adrien Thério, ancien étudiant et professeur à l’U d’O, qui a joué un rôle clé dans l’émergence d’une nouvelle génération d’auteur.ice.s. Elle explique d’ailleurs que les années 1980-1990 étaient un véritable « âge d’or », durant lequel les cours de création littéraire étaient non seulement populaires, mais aussi directement liés aux maisons d’édition franco-ontariennes, permettant ainsi aux étudiant.e.s d’être publié.e.s, notamment par Prise de Parole ou Le Nordir.
Véronique Sylvain, poète et lauréate du Prix Trillium en 2020, évoque avec émotion l’influence déterminante de ses professeur.e.s à l’U d’O. Sylvain explique que c’est en suivant un séminaire de création littéraire animé par Robert Yergeau, qui devint ensuite son directeur de thèse de maîtrise aux côtés de Lucie Hotte, qu’elle a véritablement découvert sa vocation littéraire. Elle précise que les premiers poèmes de son recueil Premier quart ont d’ailleurs été rédigés à l’issue de ce séminaire.
Cependant, Hotte souligne que la disparition progressive des cours consacrés à la littérature franco-ontarienne et des ateliers de création littéraire à l’U d’O a fragilisé l’avenir de cette production littéraire locale. Elle explique aussi que l’Université ne compte plus aucun.e professeur.e spécialisé.e en littérature franco-ontarienne parmi ses rangs et que les cours dédiés à ce domaine disparaissent donc peu à peu.
Paré partage un constat similaire : selon lui, l’U d’O ne joue plus le rôle moteur qu’elle a pu occuper auparavant dans la littérature franco-ontarienne. Il souligne que la réduction des financements et la marginalisation de la langue française sur le campus limitent les possibilités de formation pour les futur.e.s écrivain.e.s.
Quel avenir pour la littérature franco-ontarienne ?
D’après les deux expert.e.s, l’héritage littéraire ottavien repose aujourd’hui sur une double responsabilité : d’une part, les écrivain.e.s doivent continuer à écrire pour que la littérature franco-ontarienne rayonne. D’autre part, les institutions doivent garantir que le développement et la pérennité de cette littérature.
Hotte mentionne que de plus en plus de maisons d’édition franco-ontariennes ont fermé au fil des années : Vermillon, Nordir ou encore les Éditions du Gref en sont quelques exemples. Il est donc crucial, d’après elle, de repenser la place de la littérature franco-ontarienne à Ottawa.
Hotte assure que des initiatives existent : Les Presses de l’Université d’Ottawa publient encore des ouvrages sur la francophonie canadienne et des chercheur.se.s indépendant.e.s poursuivent leurs travaux sur la littérature franco-ontarienne. De plus, des auteur.ice.s tel.le.s que Véronique Sylvain maintiennent des liens avec l’U d’O en intervenant ponctuellement dans des conférences et des rencontres avec des étudiant.e.s. Toutefois, pour les expert.e.s, si l’U d’O veut conserver son rôle d’incubateur littéraire, il lui faudra recruter des spécialistes et renforcer les liens avec les maisons d’édition et les événements littéraires.
Le Salon du livre de l’Outaouais, qui se tiendra du 20 au 23 février, incarne justement cette volonté de mettre de l’avant la littérature franco-ontarienne.
