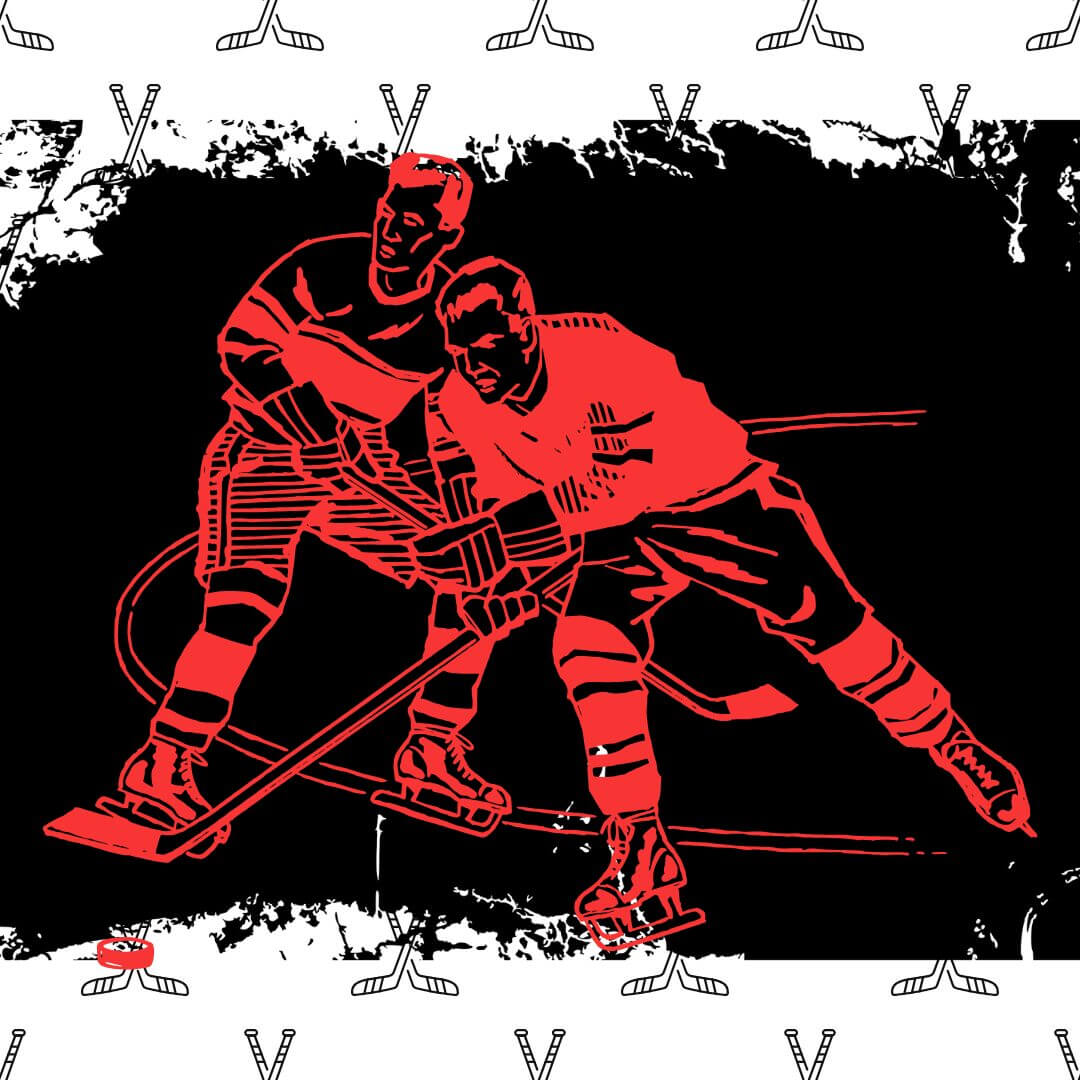
Gants, glace et glorification de la violence
Crédit visuel : Hidaya Tchassanti — Directrice artistique
Chronique rédigée par Charlie Correia — Journaliste
La violence au sein du hockey est omniprésente depuis de nombreuses décennies. Lorsque les joueurs « jettent les gants », la foule hurle d’excitation. Parmi les spectateur.ice.s, des jeunes sont témoins de ces comportements et se réjouissent de les voir se battre. Suis-je la seule à être mal à l’aise lorsque je les vois sourire et encourager la violence derrière la baie vitrée ? Pourquoi le phénomène semble-t-il autant normalisé ? À partir de quel moment est-il devenu une culture dans le hockey ?
Quand la violence devient la règle
Lorsqu’on réalise qu’outre les sports de combat, le hockey est le seul sport professionnel qui tolère les bagarres ouvertes, il est légitime de vouloir en comprendre les causes. Les combats sont moins fréquents de nos jours, certes, mais malgré les minutes de punition, les amendes et les sanctions, la violence persiste.
Oui, le public est diverti et cela crée des moments électrisants, mais à quel prix, surtout lorsqu’on sait que cette foule est composée de jeunes qui observent leurs idoles ? Comment expliquer aux jeunes partisan.e.s que la violence n’est pas autorisée dans la vie de tous les jours, mais que, lors d’un match, elle est justifiée ?
Depuis sa création en 1917, la Ligue Nationale de Hockey (LNH) a toujours toléré les bagarres. De fait, la bataille est formellement interdite dans la plupart des ligues, y compris au niveau international. Le hockey est un sport intense, rapide et physique. Il faut contrôler la rondelle, faire des mises en échec, et parfois, l’agressivité fait déborder les émotions.
Comme pour le nombre de joueurs ou les infractions, les affrontements violents sur la glace sont codifiés par le document officiel 2024-2025 des règlements de la LNH. C’est précisément dans la section 46 du document de 234 pages qu’est défini ce qui constitue un combat et comment « les arbitres disposent d’une très grande latitude dans les pénalités qu’ils peuvent imposer en vertu de cette règle […] ».
La règle 48 précise, quant à elle, qu’un coup intentionnel entraînant un contact avec la tête de l’adversaire est interdit. Pourtant, dans les bagarres, la tête est généralement ce qui est ciblé. Au fil du temps, des tentatives pour durcir les règles se rapportant à la tolérance de la violence ont vu le jour. Paradoxalement, la ligue réprimande les combats, mais les tolère aussi indirectement. Il y a donc un grand manque de cohérence et une trop grande latitude.
Violence ET spectacle : une forme d’éducation
Les « goons » ou les « durs à cuire » sont des joueurs désignés pour se battre. Les joueurs et le public savent que lorsque les gants tombent sur la glace, ce sont souvent ces derniers qu’on verra à l’œuvre. Leurs spécialités sont de mettre de la pression sur les adversaires, défendre leurs coéquipiers, faire passer des messages lorsque nécessaire ou faire basculer le rythme de l’adversaire.
Ce sont aussi ces joueurs qui reçoivent le plus de minutes de pénalité dans la ligue. Si on recule dans l’histoire, Tie Domi a pris part à 339 combats et 3515 minutes de pénalité entre 1990 et 2006. De nos jours, Ryan Reaves compte plus d’une centaine de batailles, 1113 minutes de pénalités et quatre suspensions depuis le début de sa carrière dans la LNH. La plupart du temps, ces joueurs vont se battre puis être dirigés vers les vestiaires sous les tonnerres d’applaudissements de la foule. Les partisan.e.s ne désirent donc pas forcément l’abolition des bagarres, et cela représente une partie du problème.
Les jeunes qui assistent aux matchs sont témoins de ces types de comportements entre joueurs et des réactions de la foule. Les différents médias ont également une part de responsabilité, car souvent, les commentateur.ice.s sportif.ve.s utilisent un langage coloré et vivant qui glorifie ce genre d’attitudes, qui sont ensuite diffusées en boucle à la télévision et dans les médias numériques.
Les jeunes ont besoin d’accompagnement pour devenir plus conscient.e.s des formes subtiles d’influence auxquelles ils.elles sont exposé.e.s. Le but est de faire de leur développement psychologique la priorité et d’éviter qu’ils.elles reprennent les mêmes types de comportements observés. Étant impressionnables, la prévention par les parents, l’école et dans leurs loisirs demeure essentielle.
D’autres risques parmi tant d’autres, mais qui en profite ?
En plus d’être problématiques pour les jeunes, les combats engendrent de sérieux risques pour la santé physique et psychologique des joueurs. Fractures, visages amochés, commotions cérébrales, symptômes dépressifs : les effets à long terme pour les joueurs sont alarmants.
Dans une étude réalisée par l’Université de Columbia, les chercheurs ont analysé un échantillon de 6039 joueurs de la LNH de 1967 à 2022. Ils ont conclu que ceux ayant pris part à 50 bagarres ou plus dans leur carrière décédaient 10 ans plus tôt que les joueurs du groupe témoin, et que les causes de décès de certains comprenaient des troubles neurodégénératifs, une surdose de drogue, un suicide ou encore des accidents de la route.
Malgré les risques connus pour leur santé, les joueurs n’hésitent pas à jeter les gants. Dans son allocution devant un panel de député.e.s à Ottawa en 2019, Gary Bettman, commissaire de la LNH, réitérait que le hockey devait demeurer un sport de contact et que la ligue avait constaté une forte baisse de la violence au fil des ans. Il semblait donc peu enclin à durcir les règles et les sanctions. Toutefois, des études démontrent que « la tolérance et l’ambiguïté quant aux comportements violents constituent un facteur organisationnel contributif à la violence en contexte sportif ».
D’ailleurs, au moment d’écrire cette chronique, Ryan Hartman du Wild du Minnesota a été suspendu sans salaire pour une période de dix matchs et mis à l’amende pour brutalité envers Tim Stützle des Sénateurs d’Ottawa. Une punition justifiée, selon moi, car Hartman est un récidiviste en la matière.
Ainsi, comment peut-on garder l’aspect spectaculaire du hockey sans que la violence soit de la partie ? Les dirigeant.e.s de la LNH ont la responsabilité d’assurer la survie du sport par le divertissement, tout en protégeant les joueurs des blessures graves. Il.elle.s doivent aussi s’assurer que leurs gestes n’aient pas d’impact négatif sur les jeunes partisan.e.s. La question reste de savoir si la société souhaite réellement bannir la violence dans les sports de non-combat.
