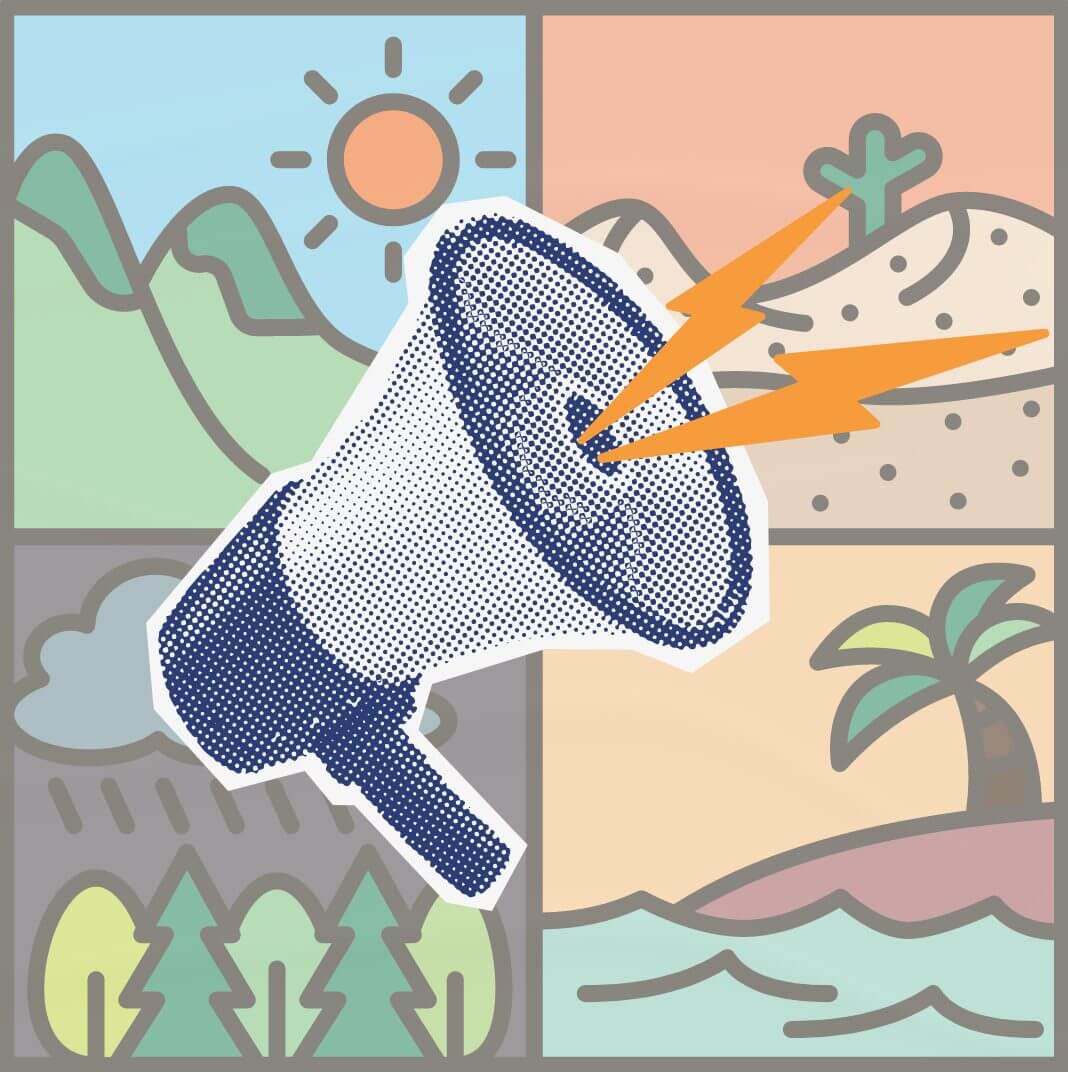
Projet de loi C-226 : Un premier pas contre le racisme environnemental
Crédit visuel : Camille Cottais – Rédactrice en chef
Article rédigé par Ismail Bekkali – Journaliste
C’est en février 2022 qu’Elizabeth May a déposé à la Chambre des communes un projet de loi inédit alliant droit environnemental et droit des populations autochtones. En juin 2024, le projet de loi C-226, qui vise à prévenir le racisme environnemental et faire progresser la justice environnementale, est finalement débattu en troisième lecture au Sénat.
Qu’est-ce que le racisme environnemental ?
Danika Littlechild est professeure à l’Université Carleton, spécialiste du droit des autochtones, avocate et ancienne vice-présidente de la commission canadienne pour l’UNESCO. Elle définit le racisme environnemental comme un ensemble de politiques, pratiques ou directives environnementales qui impactent ou désavantagent de manière disproportionnée certains individus, groupes ou communautés selon des critères raciaux. Le racisme environnemental peut être intentionnel ou non.
La professeure titulaire de la Faculté de droit à l’Université d’Ottawa et spécialiste en droit environnemental Heather McLeod-Kilmurray illustre ce concept par des cas concrets. Elle explique que les peuples des Premières Nations Aamjiwnaang au sud de la ville de Sarnia et plus récemment ceux de la réserve de Grassy Narrows sont des exemples notoires en Ontario de communautés ayant subi les répercussions de rejets toxiques dans leurs environnements naturels au cours des dernières années. Selon elle, de tels exemples se sont accumulés depuis maintenant des décennies sans qu’aucune législation telle que celle débattue en ce moment n’ait été mise en place.
Danika pointe du doigt une politique canadienne s’étant trop longtemps attardé sur des enjeux économiques plutôt que sur la sureté environnementale de ses citoyen.ne.s. En contrepartie, la professeure dénote que ce projet de loi s’inscrit dans un mouvement plus large, mais lent, de développement législatif de la part du gouvernement Trudeau concernant l’environnement et les droits des populations autochtones.
Un gouvernement à la traîne ?
Elizabeth May, députée à l’origine du dépôt de ce projet de loi, déplore en entrevue avec La Rotonde le manque de mesures législatives prises au Canada pour contrer le racisme environnemental. Il aura en effet fallu attendre 2022 pour qu’un tel projet de loi soit voté. En comparaison, c’est dès le milieu des années 90 que notre voisin étasunien a présenté un projet de loi similaire et œuvré à sa mise en place par l’investissement de milliards de dollars.
En ce qui concerne la longueur du délai de traitement, la représentante ajoute que ce retard pourrait s’expliquer par la nature même du projet de loi, en ce qu’il émane de la proposition d’une députée et non du gouvernement lui-même. Une initiative rare, dont les procédures impliquent des délais de traitement en moyenne plus longs. La députée reste néanmoins fière de son travail et de celui de ses collaborateur.ice.s, tel.le.s que la sénatrice Mary Jane McCallum, ainsi que du progrès que ce projet représente.
Une avancée à petits pas…
Littlechield convient que ce projet de loi est un premier pas et est gage d’une certaine « reconnaissance des injustices environnementales et raciales » de la part du gouvernement canadien. Elle espère sincèrement que cette initiative sera l’occasion de construire des infrastructures légales plus inclusives des communautés autochtones dans le processus de prise de décisions. De manière plus générale, la professeure affirme qu’il s’agit de l’ouverture d’un espace de pensée où dialoguent justice sociale et justice environnementale, dans la perspective d’aboutir à des réformes.
Bien qu’elle reconnaisse qu’il soit motivé par de bonnes intentions, Littlechield éprouve néanmoins une certaine réticence face à l’énoncé de la loi. Elle déplore que des termes comme « élaboration de stratégies », « justice environnementale » ou « compensations » soient employés, mais sans qu’aucune mesure concrète ne les accompagne.
En définitive, selon Littlechild, il est clair que cette nouvelle législation n’a pas de réel pouvoir coercitif pouvant empêcher les intérêts de certain.e.s de prévaloir sur la santé d’autres, et que des cas tragiques de racisme environnemental comme ceux que l’on observe en Ontario aujourd’hui sont potentiellement amenés à se reproduire.
Au-delà d’un espace où se joignent différents champs du droit, la députée Elizabeth May souhaite que ce dernier devienne également un futur milieu de coopération entre populations autochtones et gouvernement canadien. Bien que la députée admette qu’une réelle réconciliation ne peut se résumer à cette simple initiative, elle espère qu’elle sera gage d’une meilleure entente entre les deux partis et d’un gouvernement canadien plus responsable.
