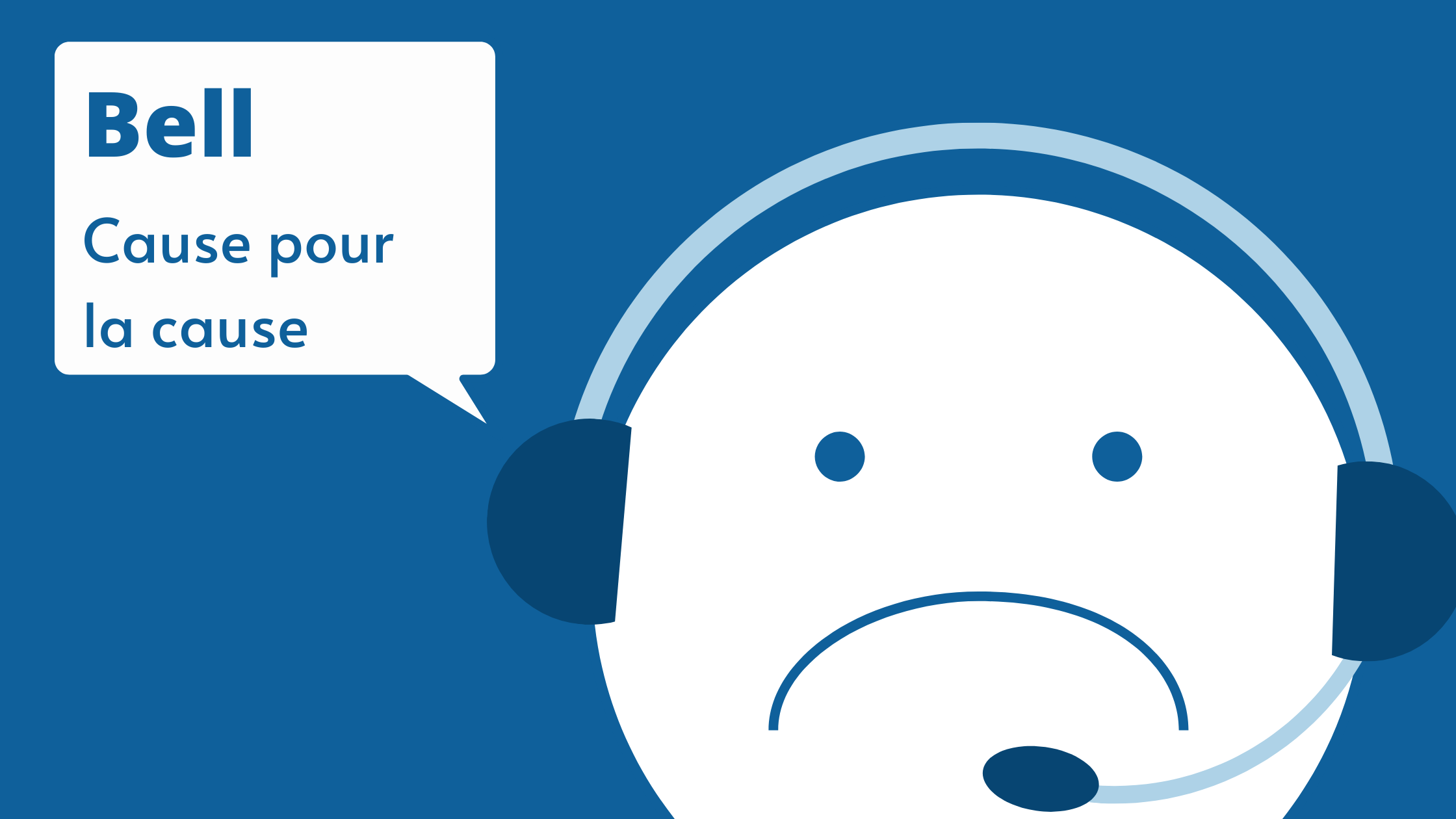Crédit visuel : Nisrine Nail – Directrice artistique
Un éditorial rédigé par Aïcha Ducharme-LeBlanc – Co-rédactrice en chef
Cette année, plus de huit millions de dollars ont été recueillis pour la santé mentale lors de Bell Let’s Talk. Combattre la stigmatisation qui marque le vécu d’une maladie mentale est la mission de Bell. Mais, quelle est l’utilité de cette initiative au-delà de la levée de fonds ? Est-elle vraiment bénéfique pour la santé mentale au Canada ?
Voici le scoop : Bell Canada n’est pas notre cheval de Troie contre le grand ennemi qu’est la santé mentale.
Bell est une entreprise hypocrite qui maltraite et néglige les problèmes de santé mentale de ses employé.e.s. L’entreprise engage des célébrités et non des professionnel.le.s de la santé mentale pour parler de la santé mentale, révélant ainsi les véritables intentions de leur campagne : le profit plutôt que la sensibilisation. Bell exploite les personnes les plus vulnérables et les plus susceptibles d’avoir des troubles de santé mentale, comme les prisonnier.ère.s qui sont contraint.e.s de verser 1 $ par minute d’appel téléphonique chez Bell.
Devons-nous vraiment faire confiance à une multinationale avide d’argent pour financer nos services de santé mentale ? Nous croyons que non.
Parlez et tout ira bien !
Notons-le bien : Bell, qui encourage les gens à discuter ouvertement sur les enjeux de santé mentale, n’est qu’une partie du problème. Il faut aussi évoquer la perception commune de la santé mentale dans le sens simpliste de « parler va tout résoudre ». Alexandre Baril, professeur agrégé en service social, estime que parler de la santé mentale est capital.
Vous remarquerez que plusieurs autres campagnes ou services de santé mentale telles que Jeunesse J’écoute, la Ligne de Crise d’Ottawa, ou encore le Service canadien de prévention du suicide, misent également sur la nécessité de parler pour « ne pas être seul.e ». Or, discuter n’est certainement pas une panacée.
Baril, qui s’intéresse dans ses recherches à la question du suicide et des personnes suicidaires, se pose la question, « quand les gens parlent – qu’est-ce qui passe ? ». Selon le professeur en service social, le contexte n’est pas toujours propice ou aidant au fait de parler de son vécu de santé mentale. Il propose le concept de suicidisme pour théoriser l’oppression que subissent les personnes suicidaires lorsqu’elles osent parler. En effet, parfois, la discussion fait plus de tort que de bien pour une personne.
En 2019, La Rotonde a présenté l’histoire de Victoria Romero-Garcia, une étudiante de deuxième année à l’Université d’Ottawa (U d’O) qui a tenté de se suicider dans une résidence de l’U d’O. Elle a parlé de ses pensées suicidaires dans le but d’obtenir de l’aide, et elle a plutôt eu droit à un traitement cruel de la part du service de logement de l’U d’O qui a mis fin à son contrat en résidence. Son « comportement [qui] a eu un impact négatif sur les gens autour d’[elle] » aurait été cité comme justification pour son expulsion.
L’expérience de Romero-Garcia n’est malheureusement pas une exception, mais la règle. Souvenons-nous de l’étudiante de l’Université de Toronto qui, en 2019, a été menottée par le service de sécurité du campus après avoir demandé de l’aide suite à des pensées suicidaires. Ou encore les nombreux.ses étudiant.e.s suicidaires de l’Université de Guelph qui sont régulièrement menotté.e.s lors de leur transfert dans un établissement psychiatrique.
Parler n’est simplement pas assez.
Logique individualiste
Pourquoi insister sur cette idée de « parler » ? Bell Canada ou même nos services de santé mentale actuels (sous-financés) individualisent la question de la santé mentale et ne tiennent pas toujours compte des facteurs structurels qui affectent ou prédisposent une personne à des problèmes de santé mentale. Prennent-ils vraiment en considération la façon dont les traumatismes intergénérationnels issus du colonialisme ont perturbé la santé mentale des peuples autochtones ? Ou les siècles de racisme institutionnalisé et systémique qui ont marqué la santé mentale des communautés noires ? Nous avons raison de croire que ces considérations ne figurent pas dans leurs priorités.
Baril expose clairement la nature insidieuse de cette individualisation néolibérale : « On présuppose que la faute ou le succès est mis sur les épaules de l’individu qui vit des enjeux de santé mentale […]. C’est [l’individu] qui doit faire des efforts pour [s]e connecter aux autres, c’est [l’individu] qui doit faire des démarches pour aller mieux. »
Est-ce la faute de l’individu si les gouvernements n’investissent pas assez dans la santé mentale ? Que la santé physique et la santé mentale sont hiérarchisées injustement, cette dernière étant souvent malmenée ? Est-ce la faute des étudiant.e.s de l’U d’O si l’administration n’a pas encore optimisé les ressources, le personnel et les services reliés au mieux-être de sa communauté étudiante ? Les carences institutionnelles en matière d’investissement dans la santé mentale ne devraient pas devenir un fardeau pour ceux et celles qui souffrent.
Comme le signale Baril, « ce n’est pas juste à la personne de changer ses comportements, mais c’est également à la société de changer la façon dont certains individus sont traités », et c’est là que Bell et d’autres font fausse route.
Création de safe spaces
Nous ne le répéterons pas assez : nous ne diabolisons pas le fait de parler de la santé mentale. Parler est crucial. Nous souhaitons toutefois que le discours aille de pair avec d’autres solutions et démarches à multiples facettes.
Par exemple, Baril préconise la création d’espaces plus sécuritaires, connus comme des safer spaces, qui favorisent une meilleure remise en forme émotionnelle et psychologique. Il explique que ces espaces peuvent se créer sous l’angle d’un accompagnement. Le but est « d’accompagner la personne à réfléchir à ce qui serait le mieux pour elle et de vraiment lui donner cet espace sécuritaire pour réfléchir avec d’autres [comme sa famille, ses ami.e.s, des professionnel.le.s de la santé, des spécialistes] », affirme-t-il.
Selon lui, c’est par l’intermédiaire de tels échanges qu’une personne affligée peut établir un lien humain et un désir de vouloir vivre. Ainsi, l’individu est appuyé et reconnaît qu’il a plusieurs options pour poursuivre son cheminement.
N’oublions pas l’importance de reconnaître les différentes formes d’oppression comme le racisme, le colonialisme, le sexisme, et le capacitisme, qui influent sur le vécu des problèmes de santé mentale d’une personne. Il faut les travailler, les déconstruire et les défaire afin de combattre intégralement la crise de santé mentale.
C’est bien de démystifier les enjeux de santé mentale en amenant les gens à en discuter librement, mais c’est loin d’être suffisant. Bell, gouvernements, l’U d’O, nous devons passer de la sensibilisation à l’action en matière de santé mentale. Posez vos téléphones, cessez de tweeter. Commencez à investir réellement dans des services bien ciblés, à vous informer sur les approches novatrices comme celle de Baril, et à mettre en œuvre des actions concrètes.