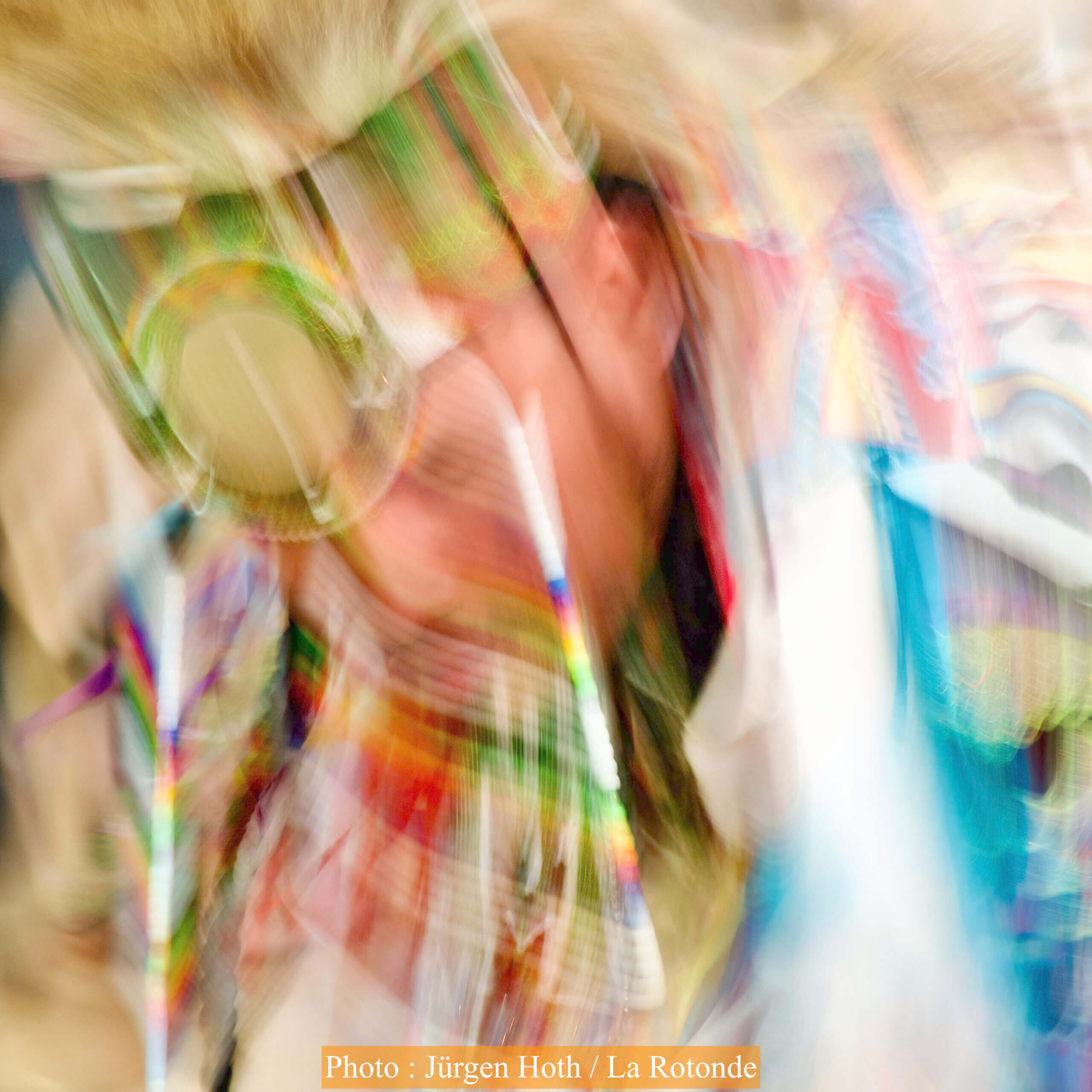Crédit visuel : Jürgen Hoth — Photographe
Article rédigé par Emily Zaragoza — Journaliste
La dernière semaine de septembre, l’Université d’Ottawa (l’U d’O) a accueilli de nombreux événements en vue de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Depuis 2021, cette journée a lieu chaque 30 septembre. Cette date, qui coïncide avec celle du chandail orange, invite les canadien.ne.s à se pencher sur l’histoire douloureuse des pensionnats et à rendre hommage aux enfants et aux familles victimes du système résidentiel. Alors que pour certain.e.s, le passé de l’U d’O serait lié à celui des pensionnats, que fait l’Université pour établir la vérité et la réconciliation ?
Événements pour la réconciliation sur le campus
C’est au son des tambours traditionnels, des chants de gorges, mais aussi des bruits de sifflets de l’arbitre, qu’a débuté la semaine de la réconciliation sur le campus. Le dimanche 24 septembre, le complexe Minto accueillait Wàskonenindamàwin : une célébration organisée chaque année par les Gee-Gees et le Centre des ressources autochtones de l’U d’O. Ce fut pour Quanah Traviss, ambassadeur de l’événement et coprésident de l’Association des étudiant.e.s autochtones (AEA), l’occasion de commencer la semaine avec des performances artistiques des Premières Nations, et athlétiques des équipes de soccer féminin et de rugby féminin et masculin.
Tout comme les sportif.ve.s des Gee-Gees, de nombreux.ses autres étudiant.e.s ont pris part à des activités pendant cette semaine. L’Association étudiante de la Faculté des arts a organisé un marché artisanal autochtone le mercredi 27 septembre. Ce même jour, devant le pavillon de la Faculté des sciences sociales se tenait l’inauguration du jardin autochtone. Deux membres de la communauté algonquine étaient présents : Mike Diabo, nouvellement employé au sein de l’U d’O, et Céline Thusky, survivante des pensionnats et membre du Centre d’amitié autochtone de Maniwaki. L’événement tenu en algonquin, en anglais et en français, a permis à Céline Thusky de raconter son histoire, de partager son rapport à la nature et ses préoccupations pour le futur. Elle qui, autrefois, était « invisible » et avait le sentiment que « personne n’entendait sa voix ».
Pour clôturer la semaine, le vendredi 29 septembre avait lieu la cérémonie officielle de l’U d’O à la Place de l’Université. La matinée a été rythmée par les discours, notamment de la chancelière Claudette Commanda et de la Provost et vice-rectrice aux affaires académiques Jill Scott, et diverses performances en l’honneur des Premières Nations. Selon Ajeet Grewal, une étudiante présente lors de l’événement, la cérémonie a pris de l’ampleur par rapport à celle de 2021. « Il y a deux ans, c’était juste quelques discours, on a noué des rubans et c’était tout. Il n’y avait pas des performances et de la nourriture comme aujourd’hui. L’U d’O a décidé d’inclure l’AEA, ce qui améliore leur initiative et montre, je pense, qu’ils veulent essayer de faire mieux. », a-t-elle raconté. Mais, aux yeux de Sophie Berthaudin, membre de l’AEA, derrière les cérémonies en grande pompe, la réalité de l’engagement de l’U d’O est bien plus mitigée.
Derrière les discours
Céline Thusky avait six ans et demi quand elle a été envoyée dans un pensionnat en 1962. Aujourd’hui elle doit « toujours se battre avec le gouvernement ». Elle aimerait que cela cesse, être « libre ». Elle a exprimé sa difficulté à se réconcilier. Selon elle, il faudrait que les institutions — notamment dans le domaine de l’éducation — reconnaissent les communautés autochtones, leurs territoires, ainsi que les torts causés envers des générations « d’enfants sacrifié.e.s ».
C’est cette « vérité cachée » que Traviss veut voir exposée au grand jour. Il est monté sur l’estrade vendredi pour faire entendre sa voix et réclamer plus d’engagement de la part de l’U d’O. « L’Université doit commencer par dire la vérité sur son histoire sombre avec le système résidentiel, chose qui n’a pas été faite jusqu’à maintenant. Ce n’est pas un hasard si le mot vérité vient avant celui de réconciliation. Sans vérité, il n’y aura pas de réconciliation. », a dénoncé l’étudiant.
Les avancées sur la voie de la réconciliation ne doivent pas se mesurer en termes d’actes symboliques, mais plutôt par l’amélioration de la situation sociale des autochtones, d’après l’activiste Pam Palmater. Le Canada est un « pays riche », mais les conditions de vie de cette minorité, victime de nombreuses discriminations, sont bien en deçà du reste de la population. Pour Palmater, si le gouvernement et l’ensemble de la société canadienne n’agissent pas dès aujourd’hui pour gommer ces inégalités, ils devront dans dix ans s’excuser pour leur inaction actuelle.
« Il faut faire plus. Il faut partager la responsabilité pour que la réconciliation ne repose pas entièrement sur les épaules de la communauté autochtone. Il faut également échanger, créer des liens, des réseaux entre les initiatives pour agir ensemble » a, ainsi, appelé de ses vœux Mike Diabo. Dans cette perspective, l’U d’O a mis en place un dispositif « d’autochtonisation » au sein du campus. Il reste à voir si les cérémonies continueront à prendre de l’ampleur et à refléter cette volonté dans les années à venir.