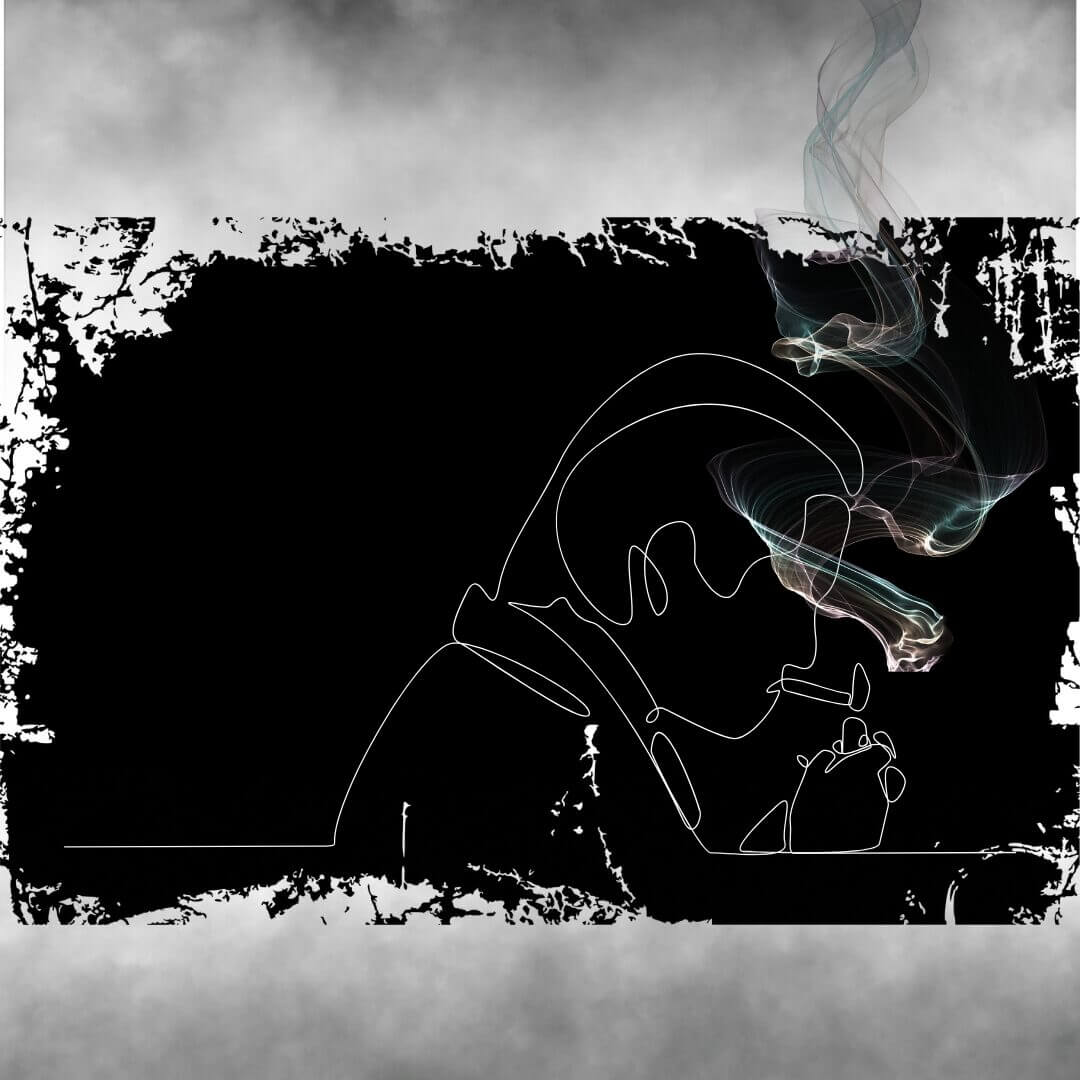
« Une génération sans tabac » : prévention efficace ou illusion politique ?
Crédit visuel : Hidaya Tchassanti — Directrice artistique
Article rédigé par Ismail Bekkali — Journaliste
Dans sa plus récente étude, le professeur Doug Coyle de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa (U d’O) propose une approche radicale : la politique d’une « génération sans tabac ». La mesure viserait à interdire définitivement l’achat de produits à base de tabac aux personnes nées après une certaine date, créant ainsi une génération qui ne pourrait jamais légalement fumer.
Si le projet s’insère dans la perspective d’une lutte antitabac, il soulève, d’après plusieurs, de nombreuses interrogations quant à son efficacité, ses conséquences sur le marché noir et son impact sur les libertés individuelles.
Une interdiction difficilement applicable
Parmi les préoccupations soulevées par cette interdiction progressive, l’une d’entre elles concerne son application et les incohérences qu’elle pourrait engendrer entre différentes générations. C’est ce qu’explique David Sweanor, professeur à Faculté de droit de l’U d’O et spécialiste en politiques de santé publique.
Selon lui, créer une distinction artificielle entre des générations proches serait « inapplicable d’un point de vue pratique » en raison de l’iniquité qu’elle produirait. « Dans quelques années, on pourra dire à quelqu’un de 35 ans qu’il.elle peut acheter ces produits, alors que son.sa cadet.te de 34 ans ne pourra pas le faire » illustre-t-il.
Jean-Sébastien Fallu, professeur à l’École de psychoéducation à l’Université de Montréal, met en avant le sentiment d’injustice que cette mesure pourrait susciter chez les personnes interdites d’achat. Il rappelle que l’adhésion aux politiques publiques repose en grande partie sur la compréhension et l’acceptation de ses fondements par les citoyen.ne.s. Or, une telle interdiction risquerait d’être perçue comme « discriminatoire » et « incohérente », indique l’expert. Il souligne également l’effet inverse chez les jeunes concerné.e.s, qui pourraient se tourner vers des alternatives plus accessibles, comme les produits de vapotage non régulés. Selon Fallu, l’interdiction pourrait ainsi encourager un effet de substitution vers les produits dont la nocivité n’est pas forcément moindre.
Vers un marché noir du tabac ?
Sweanor met en garde contre l’émergence de stratégies de contournement facilitées par des comportements individuels. « L’objectif [en matière de santé publique] sera toujours de réduire le risque que représente la commercialisation d’un produit addictif, qu’il soit faible ou élevé », rappelle-t-il.
Cependant, Sweanor relève qu’une interdiction stricte pourrait pousser les consommateur.ice.s à « confondre les articles à haut et faible risque », ce qui aboutirait à un résultat « contre-productif ». En d’autres termes, si les fumeur.se.s ne perçoivent plus la différence entre les produits, ils.elles risquent de minimiser les dangers des substances plus nocives pour la santé.
L’histoire offre déjà des précédents : Fallu évoque la prohibition de l’alcool au Canada au 20e siècle, qui, loin d’avoir endigué la consommation, a favorisé la contestation et le trafic illégal. « Peut-être qu’il y avait un peu moins de consommateur.ice.s, mais il y avait aussi des réseaux criminels, de la violence, et des personnes qui consommaient de l’alcool frelaté conçu dans des conditions non sanitaires », exprime le professeur.
Sweanor élargit la réflexion à d’autres substances, évoquant « l’impact d’illégalisation » sur des drogues plus dangereuses. « Si des personnes ayant besoin d’analgésiques ne peuvent pas s’en procurer, elles répondront à leur besoin en achetant du fentanyl. C’est le résultat d’un échec politique », affirme-t-il.
Bien que moins nocive, la nicotine, à ses yeux, n’y fait pas exception, compte tenu de son utilisation médicale allant au-delà de la simple dépendance. « Qu’il s’agisse de caféine pour se réveiller, d’alcool pour réduire les inhibitions, ou de nicotine pour traiter les troubles de l’attention et la schizophrénie, refuser l’accès à ces produits revient à forcer dans l’illégalité des personnes dans le besoin ». Selon ces experts, ces politiques de prohibition partielle ont déjà montré leurs limites, notamment en favorisant des comportements de substitution, tels que l’achat par des tiers ou le développement de marchés parallèles.
Sweanor insiste que ces lois « ne changeront pas les habitudes de dépendance, elles ne feront que déplacer le problème dans le secteur de la clandestinité », en plus de criminaliser les consommateur.ice.s. Fallu insiste quant à lui sur la stigmatisation et le sentiment de culpabilité que cette interdiction pourrait engendrer, isolant davantage les fumeur.se.s sur le plan social.
Accompagner plutôt que prohiber
Plutôt que l’interdiction stricte, Sweanor plaide pour une approche de « réduction des risques » en matière de santé publique. D’après lui, l’échec des politiques de prohibition devrait nous amener à des réflexions éthiques sur les principes mêmes de la santé publique : plutôt que d’imposer une interdiction, il s’agirait de « comprendre l’expérience vécue des personnes dépendantes et d’en tenir compte, pour leur donner les moyens de prendre de meilleures décisions concernant leur propre santé ».
Le spécialiste en politiques de santé publique cite l’exemple de plusieurs pays ayant réussi à réduire drastiquement la consommation du tabac sans passer par une interdiction totale, comme le Japon. « En huit ans, les ventes de cigarettes ont diminué de moitié, non pas avec une mesure coercitive, mais grâce à la présence d’une alternative beaucoup plus sûre sur le marché », explique-t-il.
Sweanor rappelle que la nicotine est la source de la dépendance, mais précise que « c’est bien l’inhalation du tabac qui tue ». Fournir la substance sous une forme moins toxique pourrait ainsi permettre à cet « enjeu de santé [d’être] essentiellement résolu ». Reste alors la question de la dissuasion, poursuit-il. À cet effet, le professeur à la Faculté de droit évoque plusieurs mesures économiques envisageables. Entre « système de taxation progressif » ou « incitations financières pour les produits de sevrage », plusieurs solutions permettraient d’après lui d’articuler régulation, accommodation, et prévention.
